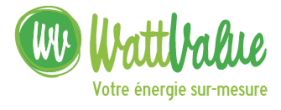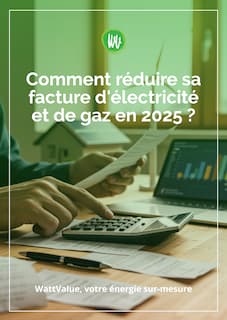L’autoconsommation consiste à consommer, en temps réel, l’énergie que l’on produit soi-même, le plus souvent grâce à l’énergie solaire via des panneaux photovoltaïques. Dans ce glossaire dédié aux entreprises, nous expliquons les notions clés, les calculs et les impacts pour piloter une stratégie d’autoproduction efficace. Pour approfondir d’autres termes, consultez le glossaire énergie entreprise. Dans ce contexte, WattValue accompagne les organisations pour optimiser leurs achats groupés, suivre leurs budgets gaz/électricité et accélérer une transition énergétique locale et durable.
Définition et attributs clés
L’autoconsommation en entreprise désigne la part d’électricité produite sur site (toitures, ombrières, centrales au sol) et consommée immédiatement par les usages internes (process, CVC, éclairage, IT). L’entreprise devient ainsi producteur et consommateur, souvent qualifiée d’« autoconsommateur ». Lorsque la production dépasse la demande, le surplus peut être stocké ou injecté sur le réseau. La technologie la plus courante reste le photovoltaïque, mais d’autres EnR peuvent contribuer selon les sites.
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Production | Énergie produite sur site (principalement photovoltaïque) selon l’ensoleillement et la puissance installée; profil variable et intermittent. |
| Consommation | Profil de charge de l’entreprise (jours/heures ouvrés, week-ends, saisonnalité); optimisation via pilotage, déplacement d’usages et stockage. |
| Photovoltaïque | Générateur solaire, onduleurs et supervision; dimensionnement précis pour maximiser l’autoconsommation et limiter l’injection. |
Calcul des indicateurs clés
Taux d’autoconsommation
Proportion de la production consommée sur site. Formule: énergie produite et consommée sur place ÷ production totale. Un taux élevé signifie peu de surplus injecté.
Taux d’autoproduction
Part de la consommation totale couverte par la production locale. Formule: énergie produite et consommée sur place ÷ consommation totale. Un taux élevé traduit une plus faible dépendance au réseau.
Données et mesure
Installez un comptage de production (onduleurs, compteurs dédiés) et un comptage de consommation (poste général, sous-comptages). La précision 15-min ou 30-min est recommandée pour analyser l’alignement production/charge.
Dimensionnement économique
Le dimensionnement d’un système solaire doit arbitrer CAPEX, économies sur la facture (énergie et puissance), revente du surplus et coûts d’exploitation. Simuler plusieurs scénarios de profil de charge permet d’optimiser le retour sur investissement.
Impact opérationnel et leviers d’optimisation
Profil de charge et synchronisation
Plus la consommation est diurne et stable, plus l’autoconsommation progresse. Adapter certains usages (froid, pompes, process non critiques) aux heures ensoleillées augmente la part d’énergie solaire consommée.
Stockage et pilotage
Les batteries lissent les écarts entre production et demande. Le pilotage intelligent (EMS, GTC/GTB) priorise les usages, évite les appels de puissance et valorise l’énergie produite au bon moment.
Optimisation contractuelle
La réduction des achats réseau dépend des tarifs, de l’acheminement et de la fiscalité. Des contrats d’énergie adaptés et des achats groupés peuvent accélérer la rentabilité, tout en soutenant une stratégie EnR locale.
Exemples d’application en entreprise
Un entrepôt logistique avec 5 jours ouvrés et toitures disponibles peut viser un taux d’autoconsommation >70% en 100–500 kWc, surtout si la chaîne de froid et les convoyeurs sont pilotables. En tertiaire, un immeuble de bureaux combine production photovoltaïque et gestion CVC pour reprogrammer certains démarrages aux heures solaires. Dans l’industrie légère, l’autoproduction réduit l’exposition aux prix spot et stabilise le budget énergie. Pour des sites proches partageant une même vision, l’autoconsommation collective permet de mutualiser une production locale entre plusieurs consommateurs.
Cadre réglementaire et coûts
Les règles d’installations, de comptage, d’injection et, le cas échéant, de revente du surplus évoluent régulièrement. La CRE publie des repères utiles sur l’autoconsommation, facilitant les arbitrages entre dimensionnement, injection et valorisation.
Au-delà des aides locales, le modèle économique repose sur la baisse durable des achats d’électricité, la maîtrise du risque prix et la contribution aux objectifs RSE. Un suivi fin des données et une maintenance proactive sécurisent la performance sur la durée.
Synonymes et termes associés
L’autoconsommation s’appuie souvent sur l’énergie solaire et s’inscrit dans les EnR, avec une variante courante qu’est l’autoconsommation individuelle. De nombreux producteurs deviennent ainsi des autoconsommateurs. On parle également d’autoproduction lorsque la production locale couvre une part significative des besoins.
FAQ
Quelle différence entre taux d’autoconsommation et taux d’autoproduction ?
Le premier mesure la part de production utilisée sur site; le second la part de la consommation couverte localement. Ils se complètent pour dimensionner l’installation.
Faut-il obligatoirement installer des batteries ?
Non. Les batteries améliorent la synchronisation mais ne sont pas indispensables. Le pilotage des usages et un bon dimensionnement augmentent déjà les performances.
Quel horizon de retour sur investissement viser ?
Selon le profil de charge, le coût du kWc installé et les tarifs réseau, le TRI se situe souvent entre 6 et 10 ans, parfois moins avec des toitures bien exposées.
Peut-on combiner autoconsommation et contrats d’énergie ?
Oui. Les contrats restent nécessaires pour compléter la consommation et valoriser l’injection éventuelle. Un bon sourcing réduit les coûts résiduels.
Adopter l’autoconsommation, c’est consommer une énergie plus locale, maîtriser ses dépenses et renforcer sa résilience. Avec un cadrage technique, économique et réglementaire solide, votre entreprise accélère sa transition tout en gagnant en compétitivité.